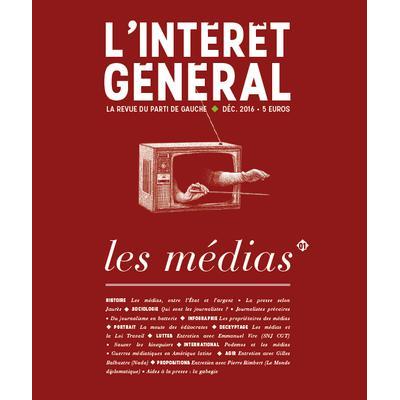Publié dans L’intérêt général, décembre 2016, numéro spécial « Les médias », et accessible sur le site d’Acrimed.
Le XXIème siècle s’est ouvert en Amérique latine avec l’arrivée au pouvoir de gouvernements progressistes : ceux d’Hugo Chávez au Venezuela (1998), de « Lula » au Brésil (2002), de Nestor Kirchner en Argentine (2003), d’Evo Morales en Bolivie (2005) ou de Rafael Correa en Équateur (2006). Une région du monde qui avait, auparavant, vu se succéder coups d’État militaires et régimes dictatoriaux. Mais désormais, ce sont d’autres méthodes qu’emploient les forces réactionnaires pour déstabiliser, voire renverser, les mêmes gouvernements progressistes.
Au Venezuela en avril 2002, un putsch est organisé contre Chávez. Or ce coup de force, qui a échoué sous la pression de millions de Vénézuéliens réclamant le retour au pouvoir de leur président élu, présente une singularité : il a été largement fomenté par les médias privés. À partir de ce putsch manqué, une nouvelle ère sombre s’est ouverte, celle des « coups d’État en douce » (pour reprendre les mots du journaliste Maurice Lemoine ((Sur le site du Monde diplomatique, en août 2014.)) ) : contre Manuel Zelaya au Honduras (2009), Fernando Lugo au Paraguay (2012), Dilma Roussef au Brésil (2016) – sans omettre des tentatives de déstabilisation en Bolivie (2008) ou en Équateur (2010). Or, la plupart de ces épisodes factieux ont été accompagnés et soutenus par de grands médias privés. Si le fait n’est pas nouveau, puisque le quotidien chilien El Mercurio avait préparé et soutenu le coup d’état militaire de 1973, l’hostilité des médias aux régimes progressistes s’est faite plus manifeste. Il arrive même qu’elle soit, tout simplement, ouvertement revendiquée par les médias eux-mêmes. Ainsi, au matin du 12 avril 2002, soit le lendemain du putsch contre Chávez, sur la chaîne de Gustavo Cisneros – plus grande fortune du pays – le présentateur Napoleón Bravo annonce fièrement : « Nous avons un nouveau président. […] Il nous faut remercier non seulement Venevisión et RCTV, mais aussi Televen, CMT et Globovisión ». « Merci aux médias ! » renchérit le directeur de l’entreprise de sondage Ceca, Víctor Manuel García, au milieu d’un parterre de putschistes réunis sur le plateau ((Comme on peut le voir dans : La révolution ne sera pas télévisée, documentaire de Kim Bartley et Donnacha O’Briain, 2003, 74 min.))… Quelques années plus tard, Judith Brito, directrice du quotidien conservateur brésilien Folha de São Paulo, résume en ces termes la nouvelle mission dont semble s’être investis les grands médias latino-américains : « Puisque l’opposition a été profondément fragilisée, ce sont les médias qui, de fait, doivent jouer ce rôle » ((O Globo, 18 mars 2010, cité par Renaud Lambert, « En Amérique latine, des États imposent le pluralisme »,Manière de voir n°146, avril-mai 2016, p. 85.)).
Prenant acte du danger qu’un tel parti pris faisait peser sur la stabilité de régimes démocratiquement élus, les gouvernements progressistes ont petit à petit réalisé combien il était important de se saisir de la question des médias. De nombreux acteurs les avaient d’ailleurs poussés à le faire, face à l’explosion des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et au caractère dépassé de dispositifs législatifs et réglementaires dans ce nouveau contexte technologique. Ainsi, le Venezuela est le premier à se lancer dans une politique d’encadrement par l’État du secteur des médias, avec la loi de responsabilité sociale à la radio et télévision promulguée fin 2004. Fin 2010, la Bolivie adopte à son tour un texte réglementant les contenus à caractère raciste ou discriminant et, en août 2011, une loi générale sur les télécommunications, les technologies de l’information et de la communication. En Équateur, la nouvelle constitution de 2008 contient également une disposition de contrôle des contenus et établit la nécessité d’une loi organique de communication, âprement discutée et qui sera finalement approuvée en juin 2013. Avant d’évoquer la philosophie et les visées de ces différents projets, arrêtons-nous sur le cas de l’Argentine, en détaillant quelque peu la législation adoptée en 2009 et le rôle qu’elle a pu jouer dans la cristallisation du débat entre l’exécutif et les grands groupes médiatiques.
En Argentine : la « guerre » entre Clarín et les Kirchner
À l’arrivée au pouvoir de Nestor Kirchner en 2003, après la terrible crise économique et sociale ayant explosé fin 2001, le seul quotidien à exprimer une franche opposition est le très conservateur La Nación. Dans un article au vitriol, le sous-directeur du journal, José Claudio Escribano, en plus d’étriller le dernier discours de campagne du tout nouveau président, prête à une source de Washington une déclaration en forme d’appel au putsch : « l’Argentine s’est résolue à se donner un gouvernement pour un an » ((Comme on peut le lire sur le site de La Nación le 15 mai 2003.)). Pis, l’écrivain et journaliste Horacio Verbitsky rapporte que le même Escribano aurait tenté d’imposer un cahier des charges en forme d’ultimatum en cinq points à N. Kirchner dans lequel il l’incitait, entre autres, à s’aligner sur les États-Unis, à ne pas rouvrir les procès des responsables de la dictature, et à réviser la position argentine face à Cuba ((Comme on peut le lire sur le site de Página12, le 18 mai 2003.))… Ce même agenda, considéré comme les « postulats basiques » de La Nación, reprenait en substance ce que l’ex-dictateur Alejandro Lanusse avait tenté d’imposer à Juan D. Perón en 1972.
Mais c’est un autre journal, Clarín, et avec lui le plus grand groupe médiatique d’Argentine, qui va se démarquer durant la présidence des époux Kirchner. On peut globalement distinguer deux étapes. La première, de 2003 à 2007, se caractérise par une bienveillance mutuelle entre le quotidien et le président Nestor Kirchner. Celui-ci ira même jusqu’à autoriser, le dernier jour de son mandat, la fusion entre Cablevisión et Multicanal, faisant du groupe Clarín le premier opérateur de câble en Argentine (avec 47% du marché) et l’un des plus importants en Amérique latine. La rupture intervient quelques temps après l’arrivée au pouvoir de Cristina Fernández de Kirchner, épouse de Nestor. Début 2008, le gouvernement décide, face au risque d’inflation causé par la hausse du cours des matières premières, d’augmenter les impôts à l’exportation. Quatre organisations du secteur agricole lancent alors, à compter du 11 mars 2008, un lock-out d’ampleur nationale qui durera jusqu’en juillet. Clarín et La Nación vont attiser ce conflit ouvert avec l’exécutif, le gouvernement les accusant en retour d’être partiaux dans leur couverture médiatique des évènements, en raison de leurs liens financiers avec l’agrobusiness (ils sont, par exemple, les principaux organisateurs d’Expoagro, le plus grand salon agricole annuel du pays). Le rédacteur en chef de Clarín, Julio Blank, reconnaîtra d’ailleurs quelques années plus tard, avoir pratiqué un « journalisme de guerre » à l’encontre des Kirchner ((Comme on peut le lire sur le site de La Izquierda Diario, le 17 juillet 2016.)).
C’est donc à compter de cette période que les relations entre la majorité et les mastodontes de la presse argentine ne vont cesser de se dégrader. Dès avril 2008, un rapport émanant de la faculté de sciences sociales de l’Université de Buenos Aires (UBA) critique le traitement journalistique peu responsable du conflit agricole, allant même jusqu’à dénoncer des pratiques discriminatoires. Repris à leur compte par la présidence et d’autres organisations officielles, ce rapport va donner un nouvel élan à l’Observatoire de la discrimination à la radio et à la télévision, créé en 2007. L’initiative est évidemment reçue très froidement par Clarín ((Comme on peut le constater sur son site, le 5 avril 2008.)) et la Société Interaméricaine de Presse (SIP), le « Medef des entreprises de presse » en Amérique latine ((Pour un aperçu de ce que représente la SIP, voir notre article publié le 17 février 2010.)). Mais elle constitue surtout le point de départ d’une nouvelle réflexion sur la réforme de la vieille loi régissant jusqu’alors les télécommunications en Argentine.
La « ley de medios »
Dès 2004, des acteurs de la société civile, réunis au sein de la Coalition pour une Radiodiffusion Démocratique (CRD), avaient présenté leur « initiative citoyenne pour une loi de radiodiffusion pour la démocratie ». Après avoir annoncé devant l’assemblée nationale son intention de remplacer la loi de 1980 issue de la dictature militaire (1976-83), Cristina Kirchner présente le 18 mars 2009, un avant-projet destiné à être débattu au sein de forums participatifs organisés sur tout le territoire argentin. Enrichi de ces échanges et des 21 points de l’initiative citoyenne, le projet de loi sur les services de communication audiovisuelle (Ley de servicios de comunicación audiovisual, LSCA) est adopté par les parlementaires et promulgué le 10 octobre 2009. Son objet : « la régulation des services de communication audiovisuelle sur tout le territoire de la République argentine et le développement de mécanismes destinés à la promotion, à la déconcentration et à l’incitation de la concurrence, à des fins de baisse des coûts [pour l’usager], de démocratisation et d’universalisation de l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication » ((Article 1 de la Loi 26.522. Nous traduisons.)).
Si le champ médiatique argentin était jusque-là fortement concentré et dominé par quelques grands groupes (Clarín, Uno, Prisa, Vila-Manzano et Cadena3), les principales dispositions de la nouvelle loi marquent une profonde rupture avec cette situation. Elles prévoient en effet : le démantèlement des monopoles, par l’interdiction pour une même entreprise de posséder une chaîne hertzienne et une chaîne câblée dans la même zone ; une redistribution permettant aux médias associatifs à but non lucratif d’accéder à un tiers de l’espace audiovisuel, à égalité avec les médias publics et privés ; et la constitution d’un nouvel organisme de régulation de l’audiovisuel.
Face à ces nouvelles règles, les grands groupes médiatiques privés du pays dénoncent une loi « controversée » ou « polémique », une manœuvre du gouvernement pour contrôler les médias et limiter la liberté d’expression, et prêtent même au couple Kirchner, la volonté « de constituer une carte des médias à leur mesure [pour] préparer le chemin en vue de l’échéance [électorale] de 2011 » ((Clarín, « El kircherismo aprobó la ley que le da al Gobierno mayor poder sobre los medios », 10 octobre 2009.)). La riposte ne se fera pas attendre : Clarín attaque la loi pour inconstitutionnalité et obtient une mesure préventive (medida cautelar) entrainant la suspension de certains articles – notamment les plus fondamentaux, ceux ayant trait aux transferts de licences et à la concentration du secteur audiovisuel. Finalement, au terme d’une bataille juridique de près de quatre ans, la Cour suprême déboute Clarín dans un arrêt du 29 octobre 2013 et valide de facto la loi dans son intégralité. Les juges ayant en effet rappelé qu’« une loi qui fixe des limites générales a priori est légitime, car elle favorise la liberté d’expression en empêchant la concentration du marché » ((Comme le rapporteLeMonde.fr, en date du 29 octobre 2013.)).
Il serait trop long de se livrer ici à un examen exhaustif des avancées et difficultés liées à l’application de cette loi ((Nous renvoyons pour cela à notre article publié le 19 novembre 2013.)). Mais deux faits marquants sont à retenir. En premier lieu, on peut déplorer qu’en parallèle à la volonté de déconcentration du paysage médiatique, le gouvernement de Cristina Kirchner ait eu recours à l’instrumentalisation d’un puissant levier d’influence : la distribution des campagnes de publicité officielle (pauta). Comme le précise le chercheur Martín Becerra ((Chercheur au Conicet et professeur à l’université nationale de Quilmes (UNQ) et à l’université de Buenos Aires (UBA).)), il s’agit là d’un « problème qui traverse toutes les administrations et qui échappe à tout critère public, réglementation et contrôle. C’est un des trous noirs de la démocratie : grâce à la publicité gouvernementale, les présidents, les gouverneurs et les maires récompensent la ligne éditoriale gouvernementale et châtient la critique. Or, « Il ne s’agit pas d’un problème mineur, puisque le volume des dépenses de l’État en publicité officielle représente 10% du gâteau publicitaire, ce qui en fait l’annonceur principal sur le marché » ((Martín Becerra, « La pauta que los parió », Revista Ajo #18, 29 février 2015.)). Ce système s’apparente ainsi à un dispositif de censure indirecte, et entraîne une forte dépendance de certains groupes de médias par rapport à la publicité officielle : quand celle-ci vient à disparaître, leur modèle économique vacille ((Voir notre article publié le 26 mai 2016, et notamment le paragraphe : Grupo 23 : une illustration de la dépendance à la « pauta ».)). En deuxième lieu, il convient néanmoins de saluer l’esprit de démocratisation de l’espace audiovisuel argentin qui anime cette loi, et qui lui a valu d’être reconnue comme exemplaire par de nombreux secteurs, de devenir source d’inspiration pour d’autres pays (Bolivie, Équateur) et d’être même qualifiée de « petite révolution » par l’organisation Reporters sans frontières. Elle a en effet permis l’ouverture d’un vaste débat au sein de la population argentine, en rassemblant, au-delà des kirchnéristes, une diversité d’acteurs pour lesquels la vitalité du débat public dépend d’un véritable pluralisme médiatique.
Un combat qui reste d’actualité
L’arrivée au pouvoir de Mauricio Macri, successeur de Cristina Kirchner, à la fin 2015, va se caractériser par une série de mesures brutales et peu démocratiques. Le nouveau chef d’État argentin fait en effet passer une série de décrets et de mesures, dont certains vont aboutir à l’abrogation de facto de la loi sur les médias de 2009. Ayant qualifié cette dernière d’« instrument de guerre dans la tentative de contrôle des médias », il souhaite la remplacer par un « cadre réglementaire clair pour la concurrence ». En d’autres termes, conformément à ses aspirations libérales et à celles de ses soutiens idéologiques (dont les grands intérêts médiatiques privés), M. Macri envisage de favoriser une plus grande concentration du champ médiatique argentin.
En définitive, l’évocation de la situation argentine montre à quel point le combat pour les médias est progressivement devenu un enjeu de lutte pour les forces progressistes. Mais si l’on observe la violente campagne qui a été menée par de grands médias brésiliens – O’Globo en tête – à l’encontre de Dilma Roussef et de la gauche brésilienne, on mesure à quel point ce combat reste toujours d’actualité. Pour autant, que conclure des différentes initiatives de réforme du champ médiatique initiées par les différents gouvernements progressistes latino-américains ? Globalement, deux tendances sont à distinguer.
Une première option consiste à s’engager sur le terrain périlleux du contrôle des contenus. Si un tel chantier, entamé par exemple au Venezuela, peut sembler s’imposer face au caractère outrancier, voire franchement discriminatoire ou injurieux, du traitement pratiqué par certains médias, il comporte un coût politique non négligeable : il renforce la polarisation politique, et donne lieu à des accusations d’autoritarisme. Ainsi, dans l’Équateur de Rafael Correa, des médias et des journalistes, et même un caricaturiste, ont été sanctionnés ou obligés de « rectifier » ce qu’ils avaient précédemment publié. Ce qui n’a pas manqué de susciter l’indignation de nombreux médias internationaux et des interrogations légitimes de la part d’anciens soutiens au régime corréiste.
La seconde option, évoquée ci-dessus à propos de l’Argentine, privilégie davantage la démocratisation des médias, c’est-à-dire, grosso modo, l’ouverture du paysage médiatique à de nouveaux acteurs marginalisés jusque-là : les médias du tiers secteur. Cette opportunité nouvelle donnée à des organisations à but non lucratif est évidemment inséparable d’une déconcentration du secteur médiatique, c’est-à-dire d’une action sur la propriété des organes de presse. À l’heure où de grands intérêts financiers continuent de dessiner la carte des médias à leur guise, cet enjeu reste crucial.
Nils Solari